Les Fables de La Fontaine, ce sont douze livres regroupés en trois tomes qui contiennent 243 fables écrites par Jean de La Fontaine. Elles sont publiées en France entre 1668 et 1694. Ces histoires sont pour la majorité inspirées des fables d’auteurs latins ou grecs comme Ésope et Phèdre, mais aussi d’auteurs plus exotiques de tradition indienne.
Les Fables de La Fontaine font partie des classiques que tout le monde se doit d’étudier et d’apprendre à l’école. Nous allons revenir sur 7 d’entre elles qui, bien qu’ayant traversé les siècles, restent toujours incroyablement d’actualité.
1. La cigale et la fourmi
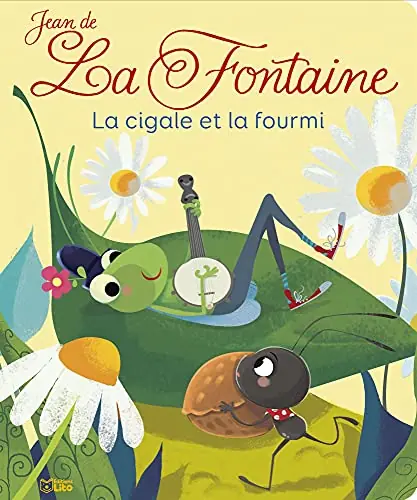
La cigale et la fourmi (1668)
C’est la première fable du livre I, elle est aussi l’une des plus connues de La Fontaine. C’est une adaptation d’une fable de l’écrivain grec Ésope, qui vécut entre le VIIe et VIe siècle avant notre ère. L’histoire est courte, mais dépeint parfaitement deux types de comportements que l’on retrouve parmi nos congénères. Celui de la cigale qui profite et qui chante tout l’été sans penser à demain, et celui de la fourmi qui travaille même lorsque c’est la belle saison en préparation de l’hiver. Cette fable est tellement populaire qu’il est passé dans le langage courant de se définir plutôt cigale ou fourmi.
Acheter2. Le corbeau et le renard
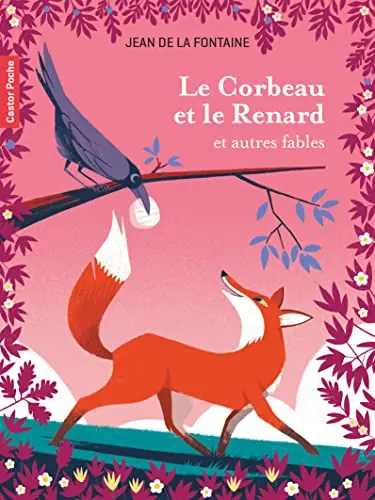
Le corbeau et le renard (1668)
Voici la deuxième fable du livre I, et probablement la deuxième plus connue et plus étudiée après La cigale et la fourmi. Fabrice Luchini en a même fait une adaptation en verlan. Cette fable est encore une adaptation d’Ésope et de Phèdre. Une fois de plus, c’est une histoire courte, qui nous apprend qu’il faut se méfier des flatteurs. Ils ont souvent un but caché, et ils utilisent la flatterie pour arriver à leurs fins. Restez donc sur vos gardes lorsque l’on veut vous laisser croire que « Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. ».
Acheter3. Le loup et l’agneau
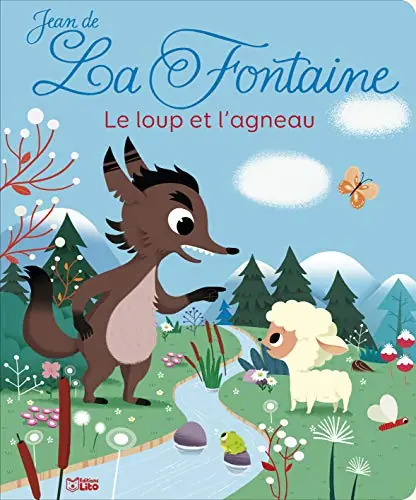
Le loup et l’agneau (1668)
C’est la dixième fable du livre I, et elle est directement inspirée de celles d’Ésope et de Phèdre. Cette fable annonce sa morale dès le premier vers « La raison du plus fort est toujours la meilleure ».
Le loup voit un agneau en train de boire à la rivière. Il cherche à l’accuser de différents méfaits, mais l’agneau lui démontre par la logique qu’il se trompe et qu’il n’y est pour rien. Mais aucune importance que l’agneau soit innocent : « Le loup l'emporte et puis le mange, Sans autre forme de procès. ». Peu importe donc que le loup ait tort ou raison, puisqu’il est le plus fort.
Acheter4. Le loup et le chien
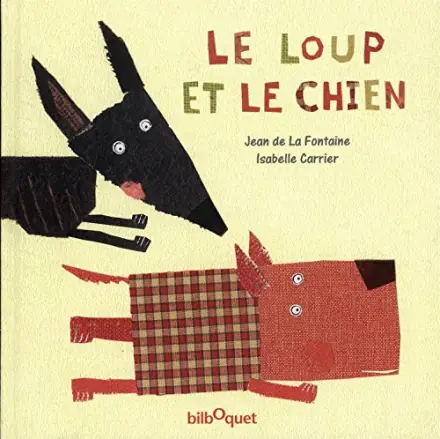
Le loup et le chien (1668)
Voici la cinquième fable du livre I, et c’est encore une adaptation de fables d’Ésope et de Phèdre. Un loup vraiment trop maigre rencontre un chien bien portant. Ce dernier lui propose de venir vivre auprès des hommes pour manger à sa faim. Mais le loup comprend que s’il accepte, il devra vivre attaché avec un collier. Aussitôt il refuse et s’enfuit, préférant garder sa liberté même au prix de la faim.
La morale de cette histoire est qu’il vaut mieux être libre, même si c’est difficile, plutôt que de vivre dans une prison dorée. C’est le thème intemporel de la sécurité contre la liberté.
Acheter5. Le lion et le rat
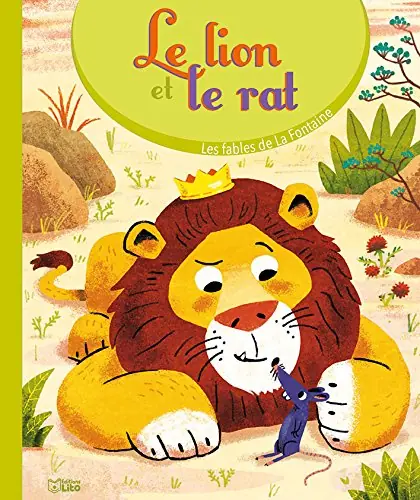
Le lion et le rat (1668)
C’est la onzième fable du livre II des Fables de La Fontaine, et c’est une réinterprétation d’une histoire d’Ésope.
« On a souvent besoin d'un plus petit que soi. ». Le roi des animaux s’en rendra vite compte, car ayant épargné un rat, ce dernier l’aidera à s’échapper en rongeant le filet dans lequel il était empêtré. L’autre morale de l’histoire est que la persévérance est parfois plus utile que la simple force : « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. ».
Acheter6. Le renard et les raisins
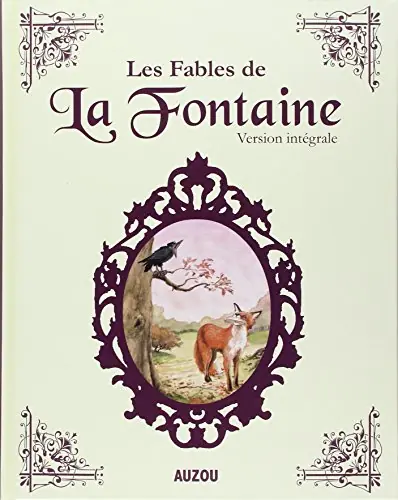
Le renard et les raisins (1668)
Voici la onzième fable du livre III. Son origine est, une fois de plus, un texte grec d’Ésope.
C’est la fable la plus courte de La Fontaine.
Un renard affamé voit de jolis raisins mûrs qu’il mangerait volontiers, mais il n’arrive pas à les atteindre. Alors plutôt que de s’avouer son échec, il conclut « Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. ». Cette fable résume parfaitement le comportement qui consiste à affirmer que l’on ne souhaitait pas vraiment ce que l’on n’a pas réussi à avoir.
Acheter7. Le lièvre et la tortue
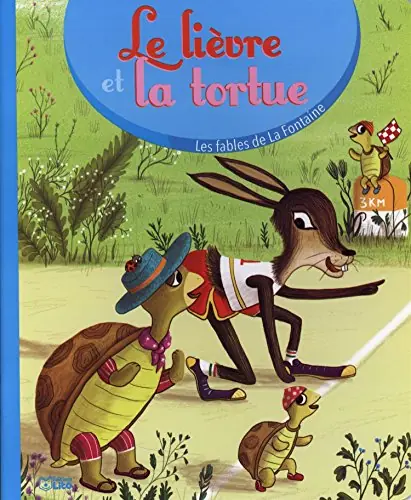
Le lièvre et la tortue (1668)
Voici la dixième fable du livre VI. Celle-ci est inspirée des Fables d’Ésope. La fable commence avec sa morale, qui est passée dans le langage courant : « Rien ne sert de courir ; il faut partir à point ».
La tortue propose une course au lièvre. Le lièvre accepte avec la certitude de gagner, mais il est tellement confiant qu’il prend tout son temps et laisse de l’avance à la tortue. Tant et si bien, qu’elle finit par gagner. On peut aussi y voir une leçon d’humilité à méditer.
Acheter
